Patrimoine africain : les musées européens face à leurs contradictions
Quand le Louvre se fait cambrioler, le mythe de la supériorité sécuritaire des musées européens vacille. Pendant qu’on dérobe des bijoux de la couronne à Paris, on continue de refuser ou de conditionner aux pays africains leurs œuvres au prétexte qu’ils ne sauraient les “protéger”. Et si le vrai scandale, c’était finalement cette vieille arrogance coloniale qui refuse de mourir ?
Il y a quelques jours, le Musée du Louvre a été victime d’un vol spectaculaire : le dimanche 19 octobre 2025, des voleurs ont pénétré en plein jour dans la Galerie d’Apollon et ont dérobé plusieurs bijoux précieux de la couronne française en seulement quelques minutes. Oui, le Louvre ! Un musée considéré comme l’un des lieux les plus sécurisés au monde.
Et ce n’est pas un cas isolé : le British Museum à Londres a reconnu, en août 2023, que plus de 2 000 artefacts avaient disparu de ses collections, dont plusieurs objets provenant d’Afrique, ce qui soulève de sérieuses questions sur la « sécurité » des œuvres (Egypt Independent, août 2023). Alors la question se pose : si les plus grands musées du monde peuvent se faire cambrioler ou perdre des œuvres inestimables… sur quelle base peut-on encore dire que les pays africains ne sauraient pas « protéger » leurs propres trésors ? Parce que c’est bien là tout le paradoxe.
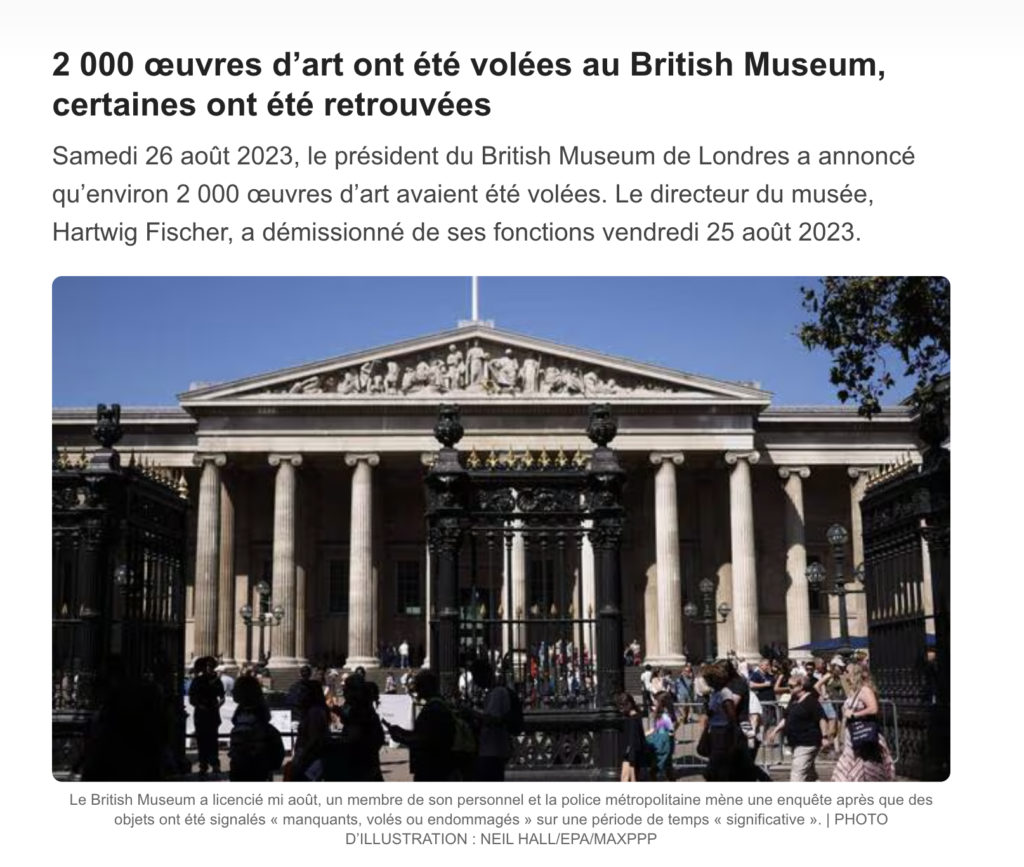
Le prétexte de la sécurité, un argument dépassé
Les musées et États européens justifient encore leur refus de restituer ces objets par le même argument : « Les pays d’origine n’ont pas les infrastructures ni les conditions de sécurité nécessaires. » Cet argument revient d’ailleurs régulièrement dans le discours officiel. Le rapport Sarr-Savoy (2018) souligne que les institutions européennes invoquent souvent la « conservation, la stabilité politique et la sécurité » comme obstacles aux restitutions.
Dans un article du Monde (23 novembre 2018), plusieurs directeurs de musées expliquent « craindre pour la préservation et la sécurité » des œuvres une fois restituées. Même son de cloche du côté de la BBC (août 2023), où des musées britanniques rappellent que « les risques de dégradation ou de vol dans les pays d’origine » sont, selon eux, un frein majeur. Sauf que… c’est un peu facile. Et surtout, c’est oublier que ces objets ont été pris dans des conditions violentes, souvent sans aucun consentement, pendant la colonisation ou les expéditions impériales.

L’universitaire et écrivain Felwine Sarr et l’historienne française Bénédicte Savoy ont d’ailleurs remis, en 2018, un rapport à Emmanuel Macron sur la restitution du patrimoine africain. Ils y expliquent que 90 % des œuvres africaines se trouvent encore hors du continent, notamment dans des musées européens. Rien qu’au Musée du Quai Branly, on compte plus de 70 000 objets venus d’Afrique : masques, sculptures, instruments de musique, objets de culte… bref, des morceaux entiers d’histoire et de spiritualité.

Et c’est aussi le cas pour les trésors venus d’Afrique du Nord. Des statues, des momies, des bijoux, des bas-reliefs ou encore la Pierre de Rosette, découverte en 1799, sont toujours conservés dans des musées européens notamment au British Museum malgré les demandes répétées de restitution. Un patrimoine essentiel, arraché à sa terre d’origine. Mais ce qu’on dit moins, c’est que l’Afrique avance, et vite.
L’Afrique prend son destin culturel en main
Les pays africains n’attendent plus l’accord de l’Europe pour se doter d’institutions solides. Le Bénin a inauguré, en 2022, le Musée d’Histoire d’Abomey, un complexe ultramoderne cofinancé par l’État béninois et l’Agence française de développement, destiné à accueillir les œuvres restituées et à former une nouvelle génération de conservateurs africains. En 2023, la réalisatrice Mati Diop a abordé dans un film documentaire la restitution de 26 trésors royaux au Bénin, autrefois appelé Dahomey. Vingt-six objets parmi des milliers qui avaient été pillés par l’armée coloniale française en 1892. Elle donne la parole à l’un d’eux : la 26ᵉ statue, qui quitte le musée du Quai Branly pour retrouver sa terre d’origine et suit des débats passionnants entre étudiants béninois, qui réfléchissent notamment au sens politique de cette restitution, à la mémoire historique.
Le Sénégal, de son côté, a ouvert le Musée des Civilisations Noires à Dakar, l’un des plus grands musées du continent, capable d’accueillir des œuvres dans des conditions de conservation internationales.
Le Nigeria construit actuellement le Edo Museum of West African Art à Benin City, en collaboration avec le British Museum et l’architecte ghanéen David Adjaye preuve qu’il existe des ponts entre les institutions. Et l’Égypte, avec son Grand Egyptian Museum ouvert au pied des pyramides de Gizeh, est aujourd’hui à la pointe mondiale de la muséologie et de la conservation des trésors patrimoniaux.

Et surtout, sur le terrain, des femmes comme Marie-Cécile Zinsou, fondatrice de la Fondation Zinsou à Cotonou, montrent depuis des années qu’il est possible de créer, d’éduquer et de préserver un patrimoine africain vivant et accessible à tous. Sa fondation, pionnière au Bénin, combine éducation artistique, expositions d’art contemporain et travail de mémoire historique, contribuant à redéfinir la place de l’Afrique dans le monde de l’art.
Ces exemples montrent que les pays africains ont les infrastructures, les compétences et la volonté. Et qu’au-delà de la restitution, il s’agit désormais de reconnaître leur légitimité culturelle.
Anastasie Chloé pour BY US MEDIA
